- La Chimie des Huiles Essentielles
- 0 aime
- 545 points de vue
- 0 commentaires
Qu’est-ce que le chémotype d’une huile essentielle ?
Le chémotype, également appelé "chimiotype" ou "race chimique", désigne la "signature chimique" d'une huile essentielle, soit une sous-catégorie chimique au sein d'une même espèce de plante. Ce concept est apparu pour la première fois en 1975 grâce à Pierre Franchomme. L'Union Européenne l'a officialisé en 2006 avec l'adoption du règlement REACH, visant à sécuriser la fabrication et l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne.
L’importance du chémotype des huiles essentielles
Le chémotype joue un rôle clé pour différencier les huiles essentielles issues de la même espèce végétale, car leur composition biochimique peut varier selon divers facteurs : origine géographique, climat, type de sol, ensoleillement, saison, etc. Ces variations entraînent des propriétés médicinales et pharmacologiques distinctes. Connaître le chémotype est donc essentiel pour éviter les erreurs d'utilisation pouvant avoir des conséquences sur la santé.
Afin de déterminer ces chémotypes, on utilise la chromatographie, une méthode de séparation chimique permettant de mesurer les variations de concentration des composants dans un échantillon.
Exemples de différents chémotypes
-
Romarin (Rosmarinus officinalis)
-
Romarin cinéole : Le romarin cultivé en Tunisie ou au Maroc, riche en 1,8-cinéole, produit une huile essentielle aux propriétés expectorantes, idéale pour les affections respiratoires.
-
Romarin verbénone : Celui qui pousse en Corse contient plus d’acétate de bornyle, une substance bénéfique pour le foie et les voies biliaires.
- Romarin camphre : En Provence ou dans le sud de l’Espagne, le romarin est plus riche en camphre, favorisant l’activité cardiaque et musculaire, bien qu’il puisse être hépatotoxique.
-
-
Thym (Thymus vulgaris)
- Thym vulgaire : Le thym présente 7 chémotypes : thymol, alpha-terpinéol, carvacrol, géraniol, linalol, paracymène et thuyanol. Par exemple, le thym qui pousse près de la Méditerranée dégage une odeur forte et phénolée (thym carvacrol), tandis que le thym de Haute Provence offre des notes plus douces rappelant la lavande fine (thym linalol) ou le géranium rosat (thym géraniol). Dans d'autres régions, on peut retrouver des fragrances de marjolaine, d'eucalyptus ou encore de verveine citronnée.
Ces exemples illustrent bien l'importance de connaître le chémotype pour une utilisation optimale des huiles essentielles.




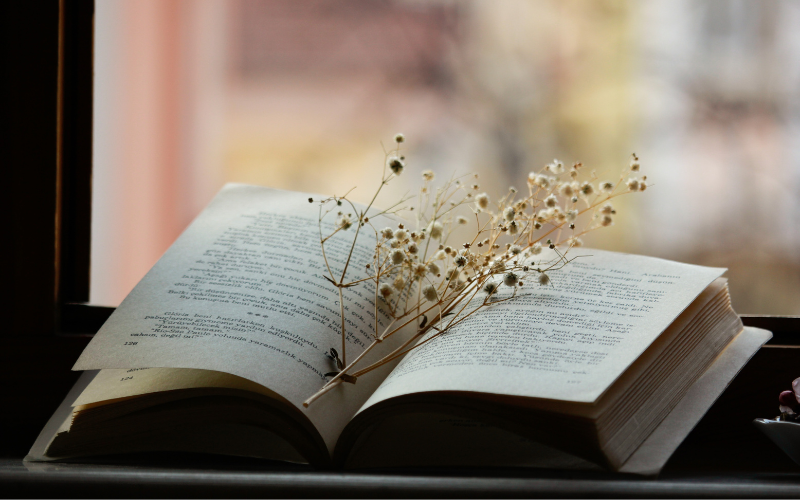



Commentaires (0)